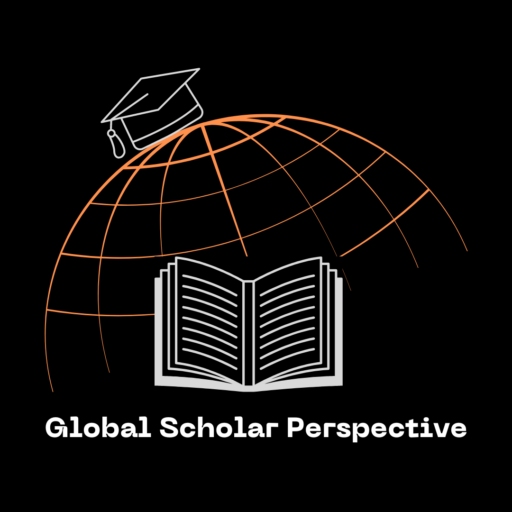Un titre volontairement polémique pour un article d’opinion, reflétant la lassitude et la perte d’espoir en un changement pacifique.
C’est une affirmation difficile à formuler, mais c’est pourtant ce que l’on ressent en observant la politique intérieure du pays depuis un an.
Il y a un an, j’écrivais que la Géorgie risquait de devenir une seconde Biélorussie — un régime autoritaire, fantoche, soutenu par Moscou. Les mois ont passé, et, malheureusement, il faut aujourd’hui se rendre à l’évidence : la Géorgie est devenue un État-bananier.
Mois après mois, le parti au pouvoir s’en est pris à l’opposition, à l’Europe et aux diplomates occidentaux, avançant un discours oscillant entre les narratifs du « parti mondial de la guerre », de l’anti-genre, des « agents étrangers » et d’un prétendu agenda libéral occidental décadent imposé par les LGBTQ. Leur base électorale ne s’est peut-être pas élargie de manière significative, mais l’apathie des électeurs pro-européens et de l’opposition, elle, s’est accrue.
Cela s’est clairement vu lors des récentes élections municipales, où une majorité d’électeurs ont boycotté les urnes, faute d’alternative crédible — offrant ainsi au parti Rêve Géorgien des victoires écrasantes, dépassant parfois les 80 % dans certaines municipalités.
Comment peut-on les en blâmer ?
Le paysage politique du pays est plus délabré que jamais. L’espoir que nourrissaient encore les citoyens en décembre 2024 s’est évanoui, remplacé par la triste réalité d’une opposition trop fragmentée pour s’unir et travailler ensemble. Mais peut-on vraiment reprocher à ses politiciens d’être divisés, quand la route vers le pouvoir ressemble davantage à un champ de mines qu’à un champs de coquelicots ?
Ces derniers mois, plusieurs nouvelles figures ont émergé — avant de disparaître aussi vite qu’elles étaient apparues. Répression, chantage, pressions, corruption : tels sont les obstacles auxquels se heurte aujourd’hui quiconque ose faire de la politique en Géorgie. Les anciens leaders de l’opposition ont, eux, simplement disparu. Salomé Zourabichvili, malheureusement, n’a pas réussi à unir l’opposition, ni même à créer un front commun minimal. Ce sera sans doute là son plus grand échec politique.
La main du Rêve Géorgien s’est faite toujours plus forte, impitoyable, et — tristement — habile. Sur le plan économique, le pays ne s’en sort pas trop mal pour l’instant. « C’est la Géorgie des années 1990, mais avec l’électricité, le gaz, la communication, les transports, et un minimum de pouvoir d’achat. » Le Rêve Géorgien l’a parfaitement compris : donnez du pain au peuple, et il mangera dans votre main.
La propagande — martelant sans relâche les risques d’une « seconde Ukraine », d’une guerre, d’un effondrement économique et d’une décadence occidentale — est devenue si constante qu’une partie de la population préfère se taire, simplement pour préserver la stabilité, aussi fragile soit-elle. L’avenir paraît trop incertain pour risquer de tout perdre à nouveau dans un nouveau conflit civil.
La Géorgie a perdu — au sens où l’espoir s’est éteint.
L’espoir d’un changement pacifique et démocratique — dans l’esprit de la Révolution des Roses de 2004 — s’est dissipé. La répression grandissante de l’État, la désignation de manifestants pacifiques comme terroristes, et la prétendue (ou mise en scène) « attaque » contre le palais Orbeliani ont scellé le cercueil.
Cet événement, survenu le 4 octobre — jour des élections municipales à travers le pays — reste très contesté. En réalité, il a offert aux autorités le prétexte idéal pour présenter les manifestants pacifiques comme des radicaux violents cherchant une insurrection armée. À ce récit s’est ajoutée la découverte supposée d’une cache d’armes « prête » à être utilisée le 4 octobre, mais retrouvée le lendemain, intacte.
L’attaque contre le palais Orbeliani a sapé des mois de lutte pacifique. Dans son sillage — sous la pression croissante du gouvernement — les gens se sont retirés des rues, par peur ou par désillusion.
La Géorgie a perdu, car sous cette pression constante, la société civile est muselée ; l’opposition disparaît, est emprisonnée ou poussée à l’exil ; et les citoyens ordinaires perdent foi en toute issue pacifique. Aucun individu rationnel ou talentueux ne veut risquer sa vie dans une révolution armée.
La récente vague de soulèvements menés par la Génération Z à travers le monde — au Népal, au Maroc, à Madagascar — a brièvement ravivé l’espoir chez les Géorgiens et au sein d’une opposition épuisée, qui a tenté, une dernière fois, de se réanimer. Mais la réalité demeure sombre.
Cela me peine d’écrire ces lignes, mais la vérité est claire : il faut un tournant plus grand, un catalyseur plus fort pour réveiller le peuple. Certains pensent qu’interdire les partis d’opposition provoquera une résistance ; j’en doute. La récente opération « vitrine », présentant l’opposition comme une force terroriste prête à la révolution, n’a fait qu’accentuer la peur — ouvrant la voie à une répression encore plus dure au nom de la « paix nationale ».
Alors, que faire ?
Faut-il laisser le pays dériver vers l’orbite russe ? Non.
Nous — la diaspora géorgienne et les amis d’une Géorgie démocratique — devons redoubler de soutien à la société civile et sensibiliser l’étranger à la situation.
Mais, paradoxalement, l’Europe doit aussi adopter des mesures plus fermes contre ceux qui sont au pouvoir — et leurs familles. Même si la fortune de Bidzina Ivanichvili peut absorber la plupart des sanctions, l’Europe doit aller plus loin : suspendre le régime d’exemption de visa, couper les subventions directes au gouvernement, sanctionner le régime et ses réseaux économiques.
Nous ne voulons pas que la Géorgie se tourne vers les marchés russes ou chinois, mais il faut rendre la vie difficile à ceux qui gouvernent confortablement. Ce n’est que lorsque la vie quotidienne se détériorera pour les citoyens, tandis que l’élite au pouvoir restera riche et intouchable, que la population verra le vrai visage du régime. Ce sont ces citoyens, aujourd’hui silencieux au nom de la stabilité, qui doivent ouvrir les yeux et comprendre que le pouvoir qu’ils croient protecteur est précisément celui qui détruit leur avenir.
En parallèle, l’Europe doit financer massivement la société civile, soutenir les militants par des opportunités en Europe, et les aider à bâtir des réseaux et les fondations d’une future Géorgie démocratique. L’UE doit aussi contrer la propagande qui lui impute la responsabilité du déclin économique géorgien — en démontrant au contraire que ce déclin est le fruit de l’autoritarisme du Rêve Géorgien.
En somme, le soutien européen aux organisations locales, en particulier dans les zones rurales, doit montrer que partout où le Rêve Géorgien n’agit pas — ou choisit de détourner le regard — une Géorgie démocratique et européenne est déjà en train de se construire.
Louis Sandro Zarandia